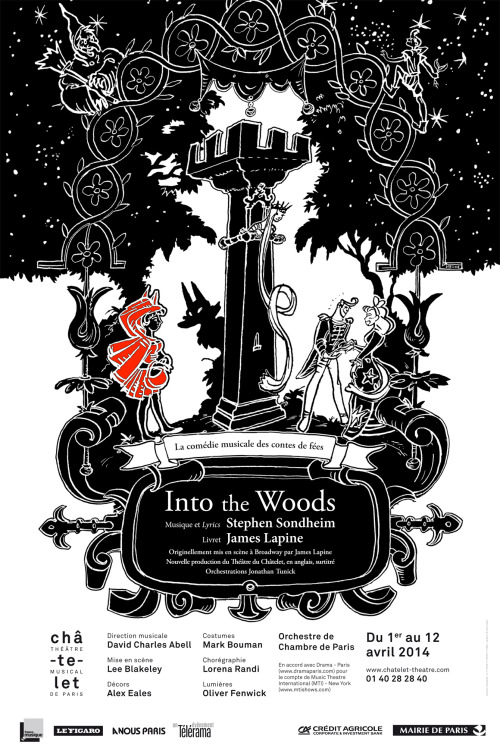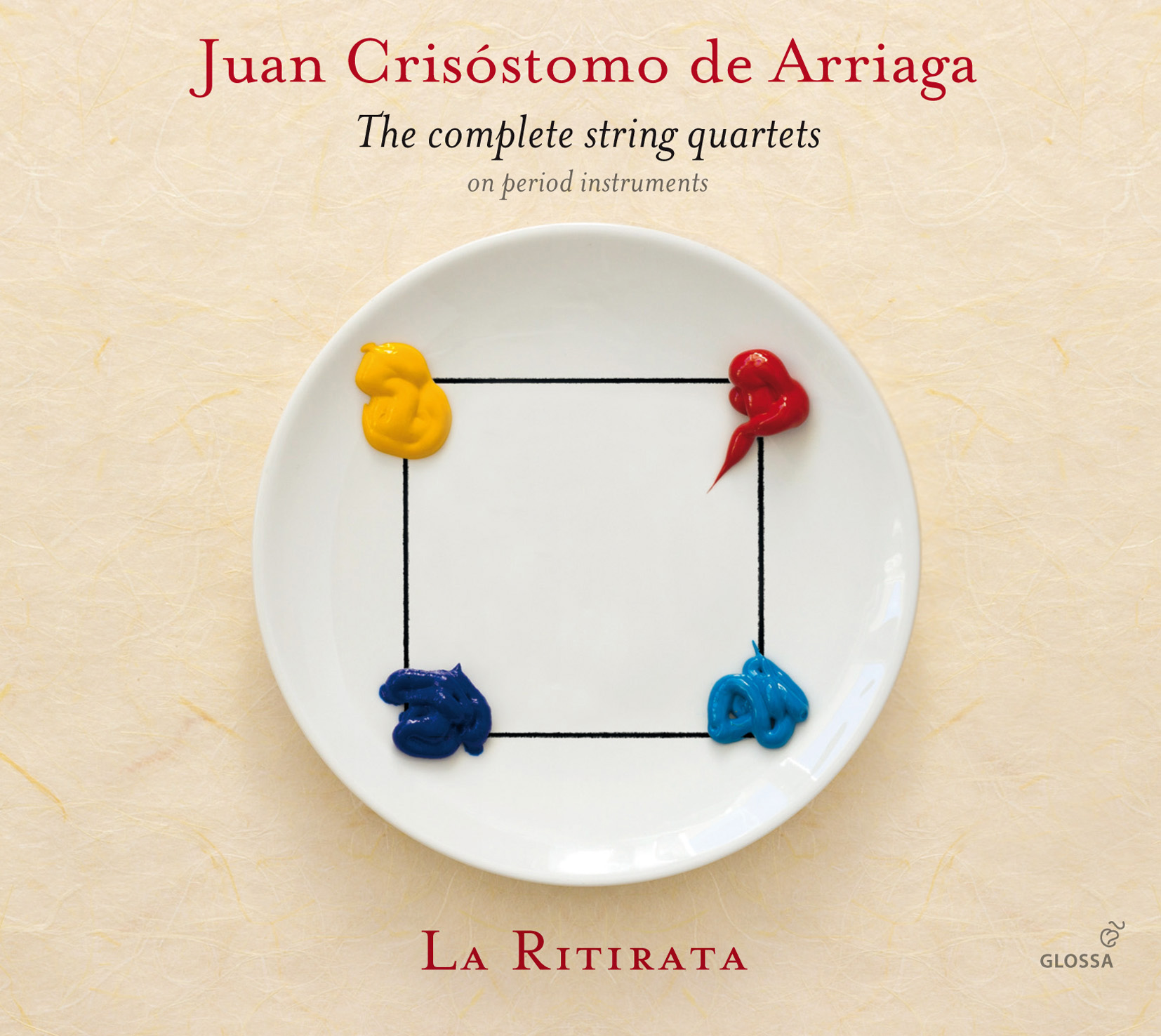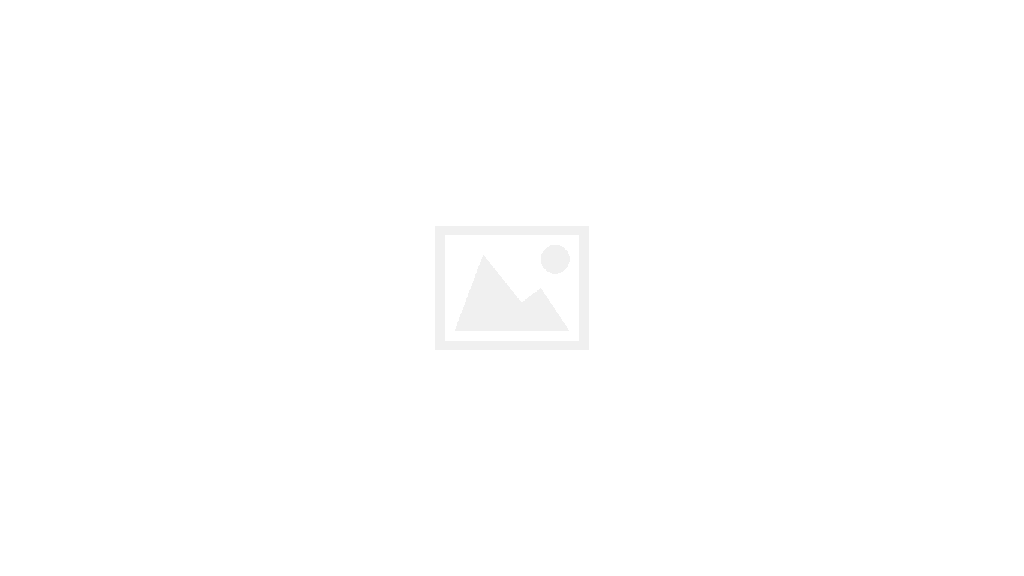![]()
Dessin du décor de la première veille du ballet.
Il ne faut pas qu’on se promette
Que je fasse en cette Gazette
De portrait aucunement bon
Du ballet dansé dans Bourbon.
Quoiqu’un brave exempt de la Reine
De m’y conduire eût pris la peine,
Et criât d’un ton haut et net :
“Ouvrez tôt, c’est monsieur Loret !”
Je fus, ou le diable m’emporte,
Plus de trois heures à la porte.
J’en étais tout à fait outré ;
Mais ce fut pis étant entré,
Car j’eus une maudite place
Où j’étais, par grande disgrâce,
Si haut, si loin, si de côté,
Que je ne vis point la beauté
De cent machines surprenantes,
Ni des perspectives charmantes. (…)
Ainsi triste, chagrin, confus,
Treize grandes heures je fus
Comme un vrai spectateur de balle,
Le plus mal placé de la salle.
Illec on vit des appareils
Qui n’eurent jamais de pareils :
Le Ciel, l’Air, la Mer et la Terre,
Les Jeux, les Ris, la Paix, la Guerre,
Un joli petit Point-du-jour
Mille fois plus beau que l’Amour
Un Soleil brillant de lumière
Et dont la beauté singulière
Se pouvait dire avec raison
L’ornement de tout l’horizon.
De plus, on y voyait encore
Les Astres, le Croissant, l’Aurore,
Maint assaut, maint rude combat,
Des sorciers allant au sabbat,
Loups-garoux, dragons et chimères,
Plusieurs galants, plusieurs commères,
Des déesses, des forgerons,
Des chrétiens, des Turcs, des larrons,
Singes, chats, carosse, incendie,
Foire, bal, ballet, comédie ;
On y vit des enchantements,
Et d’admirables changements,
Dont l’incomparable spectacle
Fit crier cinq cents fois “Miracle !”
Voilà ce que publiait, à la date du 1er mars 1653, le gazetier Loret dans sa Muse historique. Il y rend compte pour une première fois d’un ballet exécuté tout récemment au Palais-Bourbon (la plus grande salle de spectacle de Paris à l’époque), et dont il n’a pas pu pleinement profité parce qu’il y était mal placé. Il s’agit du Ballet de la Nuit. Une semaine plus tard, cependant, il publie une nouvelle « Lettre » dans la Muse historique, parce qu’il a pu revoir le Ballet de la Nuit dans de meilleures conditions.
Que de belles et grandes choses !
Que de rares métamorpheses
Dont je ne parlai nullement
Dans mes vers de dernièrement.
Entrée des Ombres par Le Concert des Nations
On le voit, ce ballet a suscité l’admiration de Loret, comme de beaucoup de ses contemporains. Il faut dire que, comme l’écrit le versificateur, le ballet occupait toute la nuit, « treize grandes heures ». Pour occuper ce long temps, il n’y avait pas moins de quarante-cinq entrées — c’est-à-dire apparition de personnages dansants nouveaux, qui chacun exécutaient une ou deux danses — groupées en quatre parties appelées, pour coller au sujet, « Veilles ». Et le ballet s’achevait sur l’image, marquante, du jeune roi Louis XIV figurant le Soleil, qui va devenir ce que l’on sait pour lui.
![]()
C’est d’ailleurs ce qui fait qu’aujourd’hui ce ballet est encore un peu connu : l’apparition finale, comme une apothéose et une épiphanie, du Roi Soleil. D’ailleurs le dessin peint bien connu qui représente Louis XIV dansant le Soleil (voir ci-dessus) est issu des costumes de ce ballet.
On en oublierait, cependant, plusieurs choses capitales. D’abord, que Louis XIV, âgé alors de treize ans, ne se contente pas de danser le Soleil, mais aussi, par exemple, une Heure, accompagné de trois autres. Il a débuté à la scène le 26 février 1651, dans le Ballet de Cassandre : il y interprétait un chevalier accompagnant deux dames de la suite de Cassandre, et aussi un paysan poitevein bondissant et dansant un tricotet (sorte de danse de l’époque) — des rôles bien éloignés, donc de celui de l’astre du jour. Anecdote amusante : ce ballet voyait aussi débuter un autre grand artisan du ballet de Cour, Isaac de Benserade, auteur des vers du livret, qui parlent des interprètes (et donc, entre autres, du roi) ; nombre de ballets ultérieurs seront accompagnés de ses vers.
Autre fait capital, peut-être plus encore que celui que je viens de rapporter : l’entrée du Soleil n’est qu’une des quarante-cinq entrées ! Et l’on oublie que, comme bien des ballets de cour antérieurs, le Ballet de la Nuit met en scène bien des personnages triviaux : bandits, Égyptiens et Égyptiennes (c’est-à-dire, à l’époque, gitans), rémouleurs, lanterniers, soldats, estropiés, culs-de-jatte, poète bouffon et faux-monnayeurs croisent néréides, songes, Parques, allégories de la Vieillesse et de la Tristesse, du Jeu (incarné par le jeune roi, dans un costume où l’on voyait un damier, des cornets à dés et des cartes), la Lune, Roger et Bradamante, Ptolémée et Zoroastre, Satan et ses démons…
D’ailleurs, ce fait est remarqué, presque trente ans plus tard, en 1682, par Ménestrier dans Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre (p. 176) :
[Le ballet] de la Nuit me paraît inimitable : on y voit des caractères de toutes sortes de personnes. Des divinités, des héros, des chasseurs, des bergers et des bergères, des bandits, des marchands, des galants, des coquettes, des Égyptiens et des Égyptiennes, des gagne-petits, des allumeurs de lancernes, des bourgeoises, des gueux et des estropiés, des personnages poétiques, les Parques, la Tristesse, la Vieilesse, des pages, des paysans, des astrologues, des monstres, des démons, des forgerons, etc. On y voit bal, ballet, comédie, festin, sabbat, toute sorte de passions, des curieux, des mélancoliques, des furieux, des amants passionnés, des amoureux transis, des plaisants, une maison en feu, des personnes alarmées. Enfin, je ne sais si jamais notre théâtre représentera rien d’aussi accompli en matière de ballet.
***
![]()
De cette abondance et de ces sept représentations — du 23 février au 16 mars 1653 —, il nous reste plusieurs éléments. D’abord, un livret imprimé, qui rapporte le contenu de chaque entrée, les vers du ballet (ceux de Benserade, donc), les noms des danseurs. Par ailleurs, plusieurs dessins, dont une partie est conservée à la bibliothèque de l’Institut, une autre au Waddeston Manor National Trust et une troisième dans les collections royales de Windsor. L’iconographie est très abondante et laisse imaginer ce que pouvaient être la splendeur et l’extrême fantaisie inventive de ce ballet. Enfin, une partition, copiée bien plus tard, dans les années 1690, par l’atelier dirigé par Philidor pour la bibliothèque musicale du roi.
Récit d’Alcine du Ballet du Duc de Vendôme (1610) par Le Poème Harmonique
On oublie aussi que la forme du ballet de cour impliquait généralement quelques passages chantés, appelés récits, et même aussi des insersions, comme une pantomime burlesque qui conte l’histoire d’Amphytrion ou un ballet dans le ballet qui narre les Noces de Pélée et Thétis — curieuse prémonition, car il y a un opéra de Cavalli, créé à Venise en 1639, et qui sera représenté à Paris justement l’année suivante ! Plus tard, cette tradition de l’insersion ira bien loin, puisque dans le Ballet des Muses de Lully sera insérée une comédie entière, Le Sicilien ou l’Amour peintre de Molière ; on appelle cela “comédie-ballet”, mais c’est en fait un ballet avec comédie dedans…
Les récits du Ballet de la Nuit sont dus à la plume de Jean de Cambefort, compositeur à peu près inconnu qui signait là de belles pages de musique.
***
Le Ballet royal de la Nuit fait partie des œuvres à l’aura mythique dont on finirait presque par oublier qu’elles ne sont pas complètement perdues. Par ses dimensions, par son arrière plan politique qui est en fait davantage un premier plan, par son faste, ce sommet du ballet de cour titille l’imaginaire de ceux qui s’intéressent à la France de l’Âge classique.
Pourtant, à ce jour, aucune véritable reconstitution n’avait été tentée — pas même une approche. Tout juste un film proposait d’en entendre un extrait — mais est-il bien la peine qu’on en parle ? il ne mérite pas vraiment d’être compté. Il y a sans doute à cette absence de tentative plusieurs explications. D’abord, l’ampleur de l’œuvre, bien sûr — mais on aurait très bien pu envisager de récréer une partie de l’œuvre, réunissant en la durée usuelle d’un spectacle d’aujourd’hui quelques passages.
En y regardant, on découvre aussi que la musique est en fait incomplète : si toute la partie de dessus de violon est conservée, une partie de la basse manque, et la majorité des parties intermédiaires est laissée en blanc, à compléter — c’est-à-dire, sans doute, à réécrire. Qui voudrait travailler sur le Ballet de la Nuit devrait se confronter à un patient travail d’écriture qui demande à la fois une connaissance intime du répertoire qui permette d’inventer dans le style approprié, et une grande modestie, justement pour se plier à ce style sans vouloir se mettre en avant.
![]()
D’autre part, le fait qu’il ne s’agît pas de musique pure mais bien d’un spectacle, incluant la chorégraphie et la scénographie, exige d’importants moyens financiers. Or, la mode n’est pas du tout, en matière scénique, à la recréation. Les compagnies spécialisées dans le “baroque” font en réalité, généralement, leur petite sauce, mâtinée de beaucoup d’invention personnelle et d’affabulation. Personne, ou presque, ne veut réellement se risquer à essayer de faire comme ça pouvait être, parce que ça n’est pas intéressant et ça n’intéresse pas le public d’aujourd’hui. Ainsi, en matière de danse, bien rares sont les spectacles réellement chevillés à la recherche et qui laissent voir ce que pouvait réellement être la danse de ces époques. Quant aux mises en scènes, quelques recherches simples suffisent à montrer que les travaux de Benjamin Lazar et Louise Moaty — si intéressants soient-ils par ailleurs — ne sont nullement des restitutions, et d’ailleurs ne veulent pas l’être et n’y prétendent pas.
Il ne saurait donc être question d’essayer de redonner aujourd’hui quelque chose qui puisse ressembler au Ballet royal de la Nuit de 1653, puisqu’en fait, à peu près aucune direction artistique ne se risquerait dans un travail de reconstitution si peu gratifiant pour l’égo, lequel, pense-t-on, ne relève que des travaux des chercheurs, et non de ceux des artistes.
![]()
© Bertrand Pichène
Les musiciens qui servent le répertoire “classique” ont davantage l’habitude de ne pas créer ex nihilo par et pour eux-mêmes, mais de se mettre au service d’un compositeur ; il n’est donc pas étonnant que le versant musical du Ballet royal de la Nuit puisse revoir un peu le jour, comme ce fut le cas lors de la première partie de la « Nuit du Rêve » à Ambronay, le 28 septembre dernier.
Il fallait, je l’ai dit, un vrai travail de fond et une vraie modestie pour y parvenir, et Sébastien Daucé a eu le courage de s’y coller, avec patience et avec une honnêteté intellectuelle. Mais pouvait-il réellement être question de servir une ou deux heures de musique de danse privée de sa destination première — le spectacle ? Sans doute pas.
Sébastien Daucé a su inventer une forme originale qui permettait d’entendre un peu du Baller de la Nuit sans toutefois tomber dans la monotonie et faire sentir au spectateur un manque (celui du scénique), comme il l’écrivait dans le programme :
La variété qui se trouvait alors dans les costumes, les danses et les décors changeant à vue provient maintenant des diverses formes musicales qui composent le Concert : des récits et des danses du Ballet original, et aussi des extraits d’autres ballets contemporains et des premiers opéras représentés en France.
À la musique du Ballet de la Nuit se mêle donc un peu de celle de deux opéras joués à peu près en même temps à la cour de France : l’Ercole amante de Cavalli et l’Orfeo de Luigi Rossi. Un choix d’autant plus pertinent que l’on sait que certains éléments de décor de cet Orfeo avaient justement été réutilisés, en 1653, par Torelli dans le Ballet de la Nuit !
Entrée des Nymphes de la Grenouillère par Le Concert des Nations
En ce qui concerne l’insersion de passages d’autres ballets, je suis plus mitigé : pourquoi, alors que le Ballet de la Nuit offre lui-même une abondance de musique, aller prendre de la musique ailleurs ? Pour quelques extraits d’autres ballets, les parties intermédiaires, dans les pièces additionnelles, existent ; c’est le cas, par exemple de l’Entrée des Ombres et de celle des Nymphes de la Grenouillière, extraites d’un Ballet du Roi de 1625, et qui se retrouvent dans la partition, bien copiée celle-là, d’un Concert donné à Louis XIII en 1627. Peut-être est-ce donc, entre autres, pour limiter le travail de réécriture que ces pièces ont été choisies. En tout cas, il n’y a rien là de bien grave.
Pour bien souligner que ce n’est pas tout à fait le Ballet royal de la Nuit qui est présenté, un titre nouveau, Concert royal de la Nuit, laisse bien apparaître qu’il s’agit désormais d’un « spectacle purement musical » (Sébastien Daucé, dans le programme), en trois parties appelées veilles comme dans l’œuvre d’origine.
Et pour lier tout cela, une idée, originale : celle de l’enchaînement. Puisque le ballet de cour consistait, en gros, en un mélange pêle-mêle de personnages, voire d’intrigues, disparates, Sébastien Daucé propose une forme semblable, dans laquelle les éléments ne s’enchaînent que deux à deux, par glissement, sans constituer une intrigue unie.
![]()
L’un des points forts du concert était bien sûr, je l’ai dit, de faire entendre quelques extraits instrumentaux du Ballet de la Nuit, dont Sébastien Daucé a patiemment réécrit les parties manquantes, et par ailleurs tous les très beaux récits de Jean de Cambefort (et Michel Lambert) qui l’émaillaient. On entend ainsi, avec beaucoup de plaisir, successivement la Nuit elle-même, dialoguant avec un chœur d’Heures, Vénus, un dialogue des Grâces, la Lune, un Dialogue du Sommeil et du Silence, et l’ultime récit de l’Aurore.
Plusieurs passages de l’Ercole amante s’y joignent, dans la seconde veille ; après le récit de la Lune composé par Cambefort, la Cintia (un des noms mythologiques de la Lune) de Cavalli intervient en dialogue avec le chœur et ils devisent de la gloire de la France. On ne peut qu’admirer la pertinence de leur placement ici, tant ils se rattachent à la fois au sujet nocturne (la Lune) et à l’arrière-plan politique. Puis, Hercule est consolé par Vénus de ses disgrâces amoureuses ; Junon, dans un long monologue, en marque ensuite son mécontentement.
Extrait de l’Orfeo de Luigi Rossi, acte II, scène 9.
La troisième veille est en grande partie empruntée à l’Orfeo de Luigi Rossi, et l’on y voit ce que l’on ne voit pas chez Monteverdi : Eurydice se réjouissant avec ses compagnes — occasion de faire entendre d’abord un touchant sommeil, puis le fameux « A l’impero d’amore chi non cederà », qui obtint en son temps un certain succès. Puis soudain, un serpent la pique — ce que figure un claquement de fouet — et Eurydice agonise, dans un long et beau récit. Suit entre autres une très belle pièce instrumentale, la Fantaisie pour les Pleurs d’Orphée… Et tandis que l’âme d’Eurydice, nous chantent Apollon et un chœur de dryades, s’envole vers l’Orient, justement, l’Aurore apparaît et chante :
Depuis que j’ouvre l’Orient
Jamais si pompeuse et si fière
Et jamais d’un air si riant
Je n’ai brillé dans ma carrière
Ni précédé tant de lumière.
Quels yeux en la voyant ne seraient éblouis ?
Le Soleil qui me suit, c’est le jeune Louis.
Et le concert s’achève sur une grande pièce instrumentale et la reprise d’A l’impero d’amore.
![]()
© Bertrand Pichène
Pour donner vie à ce vaste édifice, Correspondances est en grande formation : six violons, deux altos, deux violes, deux flûtes, basson, hautbois, trois basses de violon, deux théorbes, des percussions, deux claviers, et dix chanteuses et chanteurs. Chacun s’extrait du chœur à un moment pour chanter un récit ou un air…
L’enchantement et l’émerveillement se sont succédé sans discontinuer tout au long de la soirée. Il n’est rien qui ne fût idéal. Toutes les voix ont brillé à la fois par leurs qualités de solistes — il serait fastidieux de détailler tout le monde, ne citons donc personne : tous étaient exemplaires, et ont montré à quel point des voix diverses, parfois étonnantes, peuvent également bien servir la musique française — et leur intégration dans un chœur de très haute volée. L’orchestre s’est paré de mille couleurs et a su véritablement évoquer le spectacle et pallier l’absence de spectacle visuel en le faisant à tout moment imaginer. Sébastien Daucé, maître d’œuvre de ce Concert royal de la Nuit, l’a dirigé avec une attention constante au détail comme au tout, aux couleurs comme au théâtre, aux voix comme aux instruments, et sans effets de manche superflus.
Sébastien Daucé et Correspondances, pour leur première incursion dans le domaine profane, ont prouvé avec beaucoup d’éclat — et de succès, car le public sait bien, lui, parfois, n’être point sot, ou s’il ne le sait, le feindre — que cette musique méritait bien qu’on la joue, et mériterait bien qu’on la rejoue et qu’on la réécoute plus d’une fois. Espérons que l’occasion en sera donnée.
![]()
Et pour continuer cette « Nuit du Rêve », il nous était proposé d’entendre un programme de l’excellent ensemble Musica Nova, dont j’ai déjà parlé dans ces pages. N’étant pas spécialiste de ce répertoire, je me contenterai d’en dire quelques mots.
Nigra sum de Palestrina par Stile Antico.
Le programme, intitulé « Belle comme la lune », tournait autour de la figure de Giovanni Pierluigi da Palestrina, et s’organisait principalement en deux axes : d’une part la Missa Assumpta est Maria, qui nous rappelle que Palestrina était directeur de la musique à la Basilique Saint-Pierre de Rome, au moment où la tâche lui était confiée d’épurer la musique religieuse pour la rendre plus simple ; d’autre part, des motets sur des poèmes du Cantiques des cantiques, qui rappellent à tout moment à quel point ce livre de la Bible et cette musique regardent tout de même aussi ce qui se passe dans le monde profane. Outre les œuvres de Palestrina, on entendait aussi deux pièces de Lassus et une de Gesualdo.
Réunir côte-à-côte d’une part des motets à cinq voix du Canticum et d’autre part la Missa à six voix permettait de rappeler que la production de Palestrina est loin d’être uniforme et qu’une certaine variété y existe, et que donc tel qui connaît un versant peut ne pas bien en soupçonner un autre.
![]()
© Bertrand Pichène
L’interprétation de Musica Nova m’a paru constituer un idéal d’équilibre de toutes les voix (cinq ou six, selon les pièces), une espèce d’ataraxie sans ennui et une intensité, une sensualité même, dans la perfection des intervalles (malgré quelques intonations difficultueuses vers le début des pièces au début du concert, c’est dire assez si les imperfections se sont trouvées limitées). Le choix d’un effectif réduit, à une seule voix par partie (bien différent, donc, de l’illustration musicale que, faute de mieux, je vous propose) donne à cette musique limpidité et intelligibilité. Concentration sans doute était le maître-mot de cette deuxième partie de soirée, mais non pas une concentration grave et austère : une concentration douce, paisible, et qui, en fait, emportait l’auditeur qui savait s’y laisser prendre vers les sphères celestes. Et si l’on pouvait redouter un peu d’écouter pendant plus d’une heure ces musiques d’un accès malaisé quand on n’y est pas suffisamment habitué, le souffle musical de ce que faisait entendre Musica Nova bannissait toute forme d’ennui de l’abbatiale.
En sortant du concert, touchait-on vraiment terre ? Après le foisonnement brillant du Concert royal de la Nuit, il fallait bien l’apaisant bouillonnement polyphonique de Belle comme la Lune — et la « Nuit du rêve » d’Ambronay avait tout lieu, de fait, de se revandiquer une soirée de rêve.
![]()
Ensemble Correspondances
Caroline Meng, Violaine Le Chenadec, Caroline Weynants, Caroline Dangin-Bardot, dessus
Alice Habellion, Lucile Richardot, bas-dessus
Stephen Collardelle, haute-contre ;
Davy Cornillot, taille
Étienne Bazola, basse-taille ; Paul-Henri Vila, basse.
Béatrie Linon, Alice Julien-Laferrière, Yoko Kawakubo, Louis Creac’h, Sandrine Dupré, Gabriel Grosbard, violons
Kate Goodbehere, Brigit Gorris, hautes-contre de violon
Mathilde Vialle, Lucile Boulanger, basses de viole
Lucile Perret, Mathieu Bertaud, flûtes à bec
Benoît Laurent, hautbois ; Anaïs Ramage, basson
Julien Hainsworth, Cécile Vérolles, Pablo Garrido, basses de violon
Juan Camillo Araos, Diego Salamanca, théorbes
Arnaud de Pasquale, clavecin ; David Joignaux, percussions
Sébastien Daucé, clavecin, orgue, direction.
Ensemble Musica Nova
Christel Boiron, Marie-Claude Vallin, cantus
Lucien Kandel, Xavier Olagne, Thierry Peteau, tenor
Marc Busnel, bassus
Lucien Kandel, direction.
Références compémentaires sur le Ballet de la Nuit.
On peut consulter, entre autres, Marie-François Christout, Le ballet de cour de Louis XIV, 1643–1672, Picard, Centre National de la Danse, 2005 ; le livret de 1653 et la partitions se trouvent sur Gallica.
![]()
![]()
![]()
Illustrations musicales :
– Les entrées des Ombres et des Nymphes de la Grenouillères sont extraites du disque L’Orchestre de Louis XIII, par Le Concert des Nations, dir. Jordi Savall (Alia Vox).
– Le récit d’Alcine, de Pierre Guédron, du Ballet de Monseigneur le Duc de Vendôme est issu du disque Le Concert des Consorts du Poème Harmonique (avec Claire Lefilliâtre), dir. Vincent Dumestre (Alpha).
– L’extrait de l’Orfeo de Luigi Rossi est issu de la version des Arts Florissants, dir. William Christie (Harmonia Mundi).
![]()
– Le Nigra Sum de Palestrina est issu du disque Song of Songs de l’ensemble Stile Antico (Harmonia Mundi).












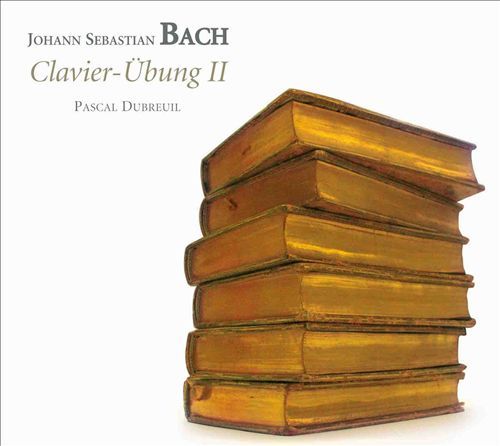












































 Je n’ai pas pris le temps encore de rendre justice au bel enregistrement du Nabucco de Falvetti par la Capella Mediterranea, mais il fait clairement partie des évènements de l’année discographique. Si certains ont fait la fine bouche en trouvant l’œuvre « moins bonne » que le Diluvio universale du même compositeur, je ne partage absolument pas leur avis. Au contraire, les deux œuvres sont assez différentes, et j’ai une certaine tendresse pour ce Nabucco moins spectaculaire, mais dont bien des pages sont superbes, à commencer par l’introduction peignant le fleuve Euphrate. Les trios des enfants de la fournaise méritent également toute l’attention de l’auditeur, et que dire de l’air «Tra le vampe» chanté par Caroline Weynants ! Leonardo García Alarcón a su tirer un excellent parti de la partition, et l’on ne saurait réduire — j’en reparlerai — son travail de maître à l’ajout de percussions et d’instruments à vents “orientaux”. Je suis frappé par les équilibres qui règnent partout dans cette lecture : équilibre des parties de l’œuvre, équilibre de la polyphonie, des instruments et des voix, équilibre des tempos… On aurait tort de s’arrêter à la séduction première qui se dégage de cet enregistrement, car au-delà de cette brillante surface (et je ne nie pas l’importance de la surface), une profondeur captivante.
Je n’ai pas pris le temps encore de rendre justice au bel enregistrement du Nabucco de Falvetti par la Capella Mediterranea, mais il fait clairement partie des évènements de l’année discographique. Si certains ont fait la fine bouche en trouvant l’œuvre « moins bonne » que le Diluvio universale du même compositeur, je ne partage absolument pas leur avis. Au contraire, les deux œuvres sont assez différentes, et j’ai une certaine tendresse pour ce Nabucco moins spectaculaire, mais dont bien des pages sont superbes, à commencer par l’introduction peignant le fleuve Euphrate. Les trios des enfants de la fournaise méritent également toute l’attention de l’auditeur, et que dire de l’air «Tra le vampe» chanté par Caroline Weynants ! Leonardo García Alarcón a su tirer un excellent parti de la partition, et l’on ne saurait réduire — j’en reparlerai — son travail de maître à l’ajout de percussions et d’instruments à vents “orientaux”. Je suis frappé par les équilibres qui règnent partout dans cette lecture : équilibre des parties de l’œuvre, équilibre de la polyphonie, des instruments et des voix, équilibre des tempos… On aurait tort de s’arrêter à la séduction première qui se dégage de cet enregistrement, car au-delà de cette brillante surface (et je ne nie pas l’importance de la surface), une profondeur captivante. Ce n’est pas tous les jours que l’on enregistre une intégrale d’un opéra de Rameau, et encore moins d’une œuvre peu connue. Pour cette raison, d’abord, Les Surprises de l’amour par Les Nouveaux Caractères méritent que l’on s’y arrête. La partition est foisonnante, l’écriture riche et terriblement inventive. Certes, le livret est assez inintéressant… Certaines voix ne m’ont pas plu, d’autres, au contraire, ont opéré une grande séduction. L’orchestre est le grand vainqueur : tous les pupitres sont superbes, avec une belle palette de couleurs et de nuances, un sens affiné de la dynamique jamais tapageuse, et un continuo exceptionnel. Le tout sous la direction souple et savante de Sébastien d’Hérin. En 2014, Rameau aura quitté ce monde depuis 250 ans ; c’est assurément l’occasion d’y jeter une oreille plus attentive !
Ce n’est pas tous les jours que l’on enregistre une intégrale d’un opéra de Rameau, et encore moins d’une œuvre peu connue. Pour cette raison, d’abord, Les Surprises de l’amour par Les Nouveaux Caractères méritent que l’on s’y arrête. La partition est foisonnante, l’écriture riche et terriblement inventive. Certes, le livret est assez inintéressant… Certaines voix ne m’ont pas plu, d’autres, au contraire, ont opéré une grande séduction. L’orchestre est le grand vainqueur : tous les pupitres sont superbes, avec une belle palette de couleurs et de nuances, un sens affiné de la dynamique jamais tapageuse, et un continuo exceptionnel. Le tout sous la direction souple et savante de Sébastien d’Hérin. En 2014, Rameau aura quitté ce monde depuis 250 ans ; c’est assurément l’occasion d’y jeter une oreille plus attentive !  L’année 2014 marquera le tricentenaire de la naissance de Carl Philipp Emanuel Bach. L’occasion, peut-être, de revenir à cette version essentielle des sonates pour viole de gambe du maître de l’Empfindsamkeit, dans la version qui, sans doute, leur rend le plus justice. Parce que Vittorio Ghielmi se joue de toutes les difficultés et domine les trois partitions avec un aplomb technique et une compréhension musicale sans faille, et parce que son frère Lorenzo Ghielmi est le partenaire idéal, qui ne se content pas d’accompagner dans l’ombre mais tient réellement sa partie — et à côté du prince des violistes, il faut pouvoir ! —, enfin parce qu’il y a ce merveilleux pianoforte de Silbermann — dont, rappelons-le, J. S. Bach a été l’un des premiers critiques, et a eu à la fin de sa vie un exemplaire chez lui —, pour toutes ces raisons, la version de Ghielmi et Ghielmi est essentiel et détrône sans la moindre hésitation les autres réalisations, plus ou moins récentes, de ces sonates.
L’année 2014 marquera le tricentenaire de la naissance de Carl Philipp Emanuel Bach. L’occasion, peut-être, de revenir à cette version essentielle des sonates pour viole de gambe du maître de l’Empfindsamkeit, dans la version qui, sans doute, leur rend le plus justice. Parce que Vittorio Ghielmi se joue de toutes les difficultés et domine les trois partitions avec un aplomb technique et une compréhension musicale sans faille, et parce que son frère Lorenzo Ghielmi est le partenaire idéal, qui ne se content pas d’accompagner dans l’ombre mais tient réellement sa partie — et à côté du prince des violistes, il faut pouvoir ! —, enfin parce qu’il y a ce merveilleux pianoforte de Silbermann — dont, rappelons-le, J. S. Bach a été l’un des premiers critiques, et a eu à la fin de sa vie un exemplaire chez lui —, pour toutes ces raisons, la version de Ghielmi et Ghielmi est essentiel et détrône sans la moindre hésitation les autres réalisations, plus ou moins récentes, de ces sonates. Cette année, j’ai découvert Boccherini — ou plutôt, j’ai découvert ce qu’il y avait de bon en lui, car j’en avais été un peu dégoûté par un disque de trios un peu fades. Je craignais de m’ennuyer un peu avec ces Sonates pour clavecin avec violon obligé, et au début, je me suis demandé dans quoi je m’embarquais… Mais Emilio Moreno et Jacques Ogg sont de fins musiciens. Il faut un peu de temps pour s’habituer à l’équilibre subtil qui se crée entre les deux instruments, et à la parfaite sobriété de leur interprétation, qui se révèle en fait expressive, mais sans effets de manche.
Cette année, j’ai découvert Boccherini — ou plutôt, j’ai découvert ce qu’il y avait de bon en lui, car j’en avais été un peu dégoûté par un disque de trios un peu fades. Je craignais de m’ennuyer un peu avec ces Sonates pour clavecin avec violon obligé, et au début, je me suis demandé dans quoi je m’embarquais… Mais Emilio Moreno et Jacques Ogg sont de fins musiciens. Il faut un peu de temps pour s’habituer à l’équilibre subtil qui se crée entre les deux instruments, et à la parfaite sobriété de leur interprétation, qui se révèle en fait expressive, mais sans effets de manche.